Transformer une raison individuelle en société de capitaux : pourquoi et comment ?
.png?width=990&height=990&name=Group%20316127811%20(1).png)
-
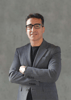
José-Carlos Torrecillas Spécialiste en solutions patrimoniales
.png?width=660&height=660&name=Group%20316127811%20(1).png)
Le dilemme initial des entrepreneurs.
Dans un précédent article, nous avons évoqué le choix auquel sont confrontés de nombreux entrepreneurs suisses lorsqu’ils lancent leur activité : faut-il commencer en raison individuelle ou créer directement une société de capitaux, comme une Sàrl ou une SA ? Beaucoup optent pour la raison individuelle, attirés par sa simplicité et sa souplesse. Mais cette forme juridique peut vite montrer ses limites, notamment lorsque l’activité se développe.
Dans la pratique, nous constatons que plusieurs raisons motivent les indépendants à envisager une transformation : la croissance de leur activité, le besoin de mieux protéger leur patrimoine privé, l’arrivée d’associés ou d’investisseurs, ou encore la recherche d’un cadre fiscal plus adapté.
La transformation d’une entreprise individuelle en société de capitaux peut se faire de deux manières. La première consiste à transférer le patrimoine existant à une nouvelle société ou à une société existante, via un apport en nature. L’entrepreneur reçoit alors des parts sociales ou des actions en échange. Cette opération demande de respecter plusieurs étapes : disposer de comptes récents (moins de six mois), établir un inventaire des actifs et passifs, rédiger un contrat d’apport conforme à la loi sur la fusion, faire établir un rapport de fondation (la décision de transfert de patrimoine fait l’objet d’un acte authentique établi par un notaire), et obtenir une attestation d’un expert-réviseur agréé. Si des collaborateurs sont employés, leurs contrats sont automatiquement transférés à la nouvelle société, conformément à l’article 333 du Code des obligations.
La seconde méthode consiste à créer une nouvelle société par apport en espèces, puis à y transférer ou vendre les actifs de la raison individuelle. Elle est généralement formalisée par un contrat de vente ou de transfert de patrimoine. Cette approche est plus souple : elle permet de sélectionner les actifs à transférer, d’éviter les dettes problématiques sous réserve d’actions légales des créanciers, et elle est moins lourde sur le plan administratif selon les actifs à transférer, notamment parce qu’elle ne nécessite pas de rapport de révision si seul du cash est apporté.
Cela dit, cette méthode présente aussi des inconvénients. Elle peut entraîner une imposition immédiate des bénéfices latents si les actifs sont vendus à un prix supérieur à leur valeur comptable. De plus, les contrats existants (bail, fournisseurs, assurances, etc.) doivent être renégociés ou résiliés, car rien n’est transféré automatiquement. Enfin, une double gestion administrative est souvent nécessaire pendant la phase de transition, notamment pour la TVA et les déclarations fiscales.
Généralement, l’apport en nature est privilégié. Il permet une continuité immédiate de l’activité, des contrats et des relations de travail. Il offre aussi la possibilité de bénéficier d’une neutralité fiscale, à condition de respecter certains critères : la société repreneuse doit rester assujettie en Suisse, les valeurs comptables doivent être reprises sans réévaluation, l’activité transférée doit constituer une exploitation ou une partie distincte d’exploitation, et les parts sociales ou actions ne doivent pas être revendues dans les cinq ans suivant la transformation.
Nous reviendrons dans un prochain article sur les implications fiscales de cette opération. Le choix entre les deux méthodes dépend de nombreux paramètres. Il est donc vivement conseillé de se faire accompagner par un conseiller fiscal et un spécialiste en restructuration d’entreprise pour prendre la meilleure décision.
Nos experts en solutions patrimoniales sont à votre disposition pour vous accompagner dans cette transition.
Auteur
-

Économiste de formation, José-Carlos Torrecillas débute sa carrière chez PWC dans le département Audit avant d'occuper des postes de manager dans diverses banques. En 2012, il obtient le brevet de conseiller financier pour devenir planificateur financier à la Baloise, puis se spécialise dans la fiscalité des PME, obtenant un CAS en 2021. Il suit actuellement un CAS en fusion, transmission et acquisition d'entreprises et est expert pour le brevet fédéral de conseiller financier et enseignant chez Kalaidos Banking+Finance School. En décembre 2023, José rejoint Piguet Galland au sein de l’équipe Solutions Patrimoniales, où il met à profit son esprit analytique affûté et son approche globale pour accompagner les clients dans leur planification financière et patrimoniale.



.png?width=488&height=440&name=Group%20316127846%20(9).png)
-1.png?width=488&height=440&name=Group%20316127846%20(1)-1.png)